Au-delà du "moment hamiltonien" #3 : Von der Leyen avance ses pions
Entre dépenses militaires, emprunt commun et création d' "enveloppes nationales", le champ des négociations budgétaires qui commencent sera immense.
La révolution lancée en 2020 avec le fonds covid a acté le raprochement entre budgets nationaux et européen, comme l’a montré la mise en oeuvre du plan de relance français. Dans ce troisième post, je fais le point sur ce qu’on sait des projets de la Commission pour le budget post-2027, à un mois et demi de leur présentation.
C’est dit : les Etats membres pourront tirer sur leur ligne de crédit dans le fonds covid pour acheter des armes. Cela a été confirmé le 4 juin lors d’une conférence de presse du vice-président Fitto et du commissaire Dombrovskis consacrée à la dernière communication de la Commission sur la Facilité pour la relance et la résilience (FRR).
“En quoi injecter des fonds dans EDIP [European Defense Industry Program, ndlr] correspond aux objectifs de la Facilité pour la relance et la résilience ?”, s’est étonnée Paola Tamma, journaliste au Financial Times. (à écouter ici, question à 11’20’’, réponse à 12’40’’).
Réponse de Valdis Dombrovskis :
“le règlement FRR lui-même ne contient pas de traitement spécifique pour les dépenses de défense, ce qui veut dire que la FRR peut soutenir des activités relatives à la défense… si c’est en ligne avec l’objectif de croissance soutenable et l’amélioration de la résilience des Etats membres”.

Que le fonds covid puisse être utilisé pour des dépenses militaires mais aussi pour capitaliser une banque publique ou financer d’autres dépenses nationales, comme suggéré dans le menu d’ “options” proposées par la Commission dans cette nouvelle communication, n’est pas une surprise. Dès lors qu’il était conçu comme un instrument de soutien budgétaire et pouvait se substituer à des dépenses déjà financées au niveau national (comme cela a été le cas en France), la fluidité entre ressources financières européennes et nationales était complète.
La fin probable du plafond de 1% de PIB
Désormais, la discussion sur le niveau du budget européen et l’émission de nouvelle dette commune est donc devenu inséparable de la situation budgétaire des Etats membres. Et il est très probable que le plafond actuel du budget européen (1% du PIB de l’UE, soit environ 190 milliards € de crédits d’engagement en 2024, hors plan de relance) saute.
La Commission a déjà posé des jalons. Depuis le fonds covid, elle a lancé en 2022 “RePowerEU”, un programme également financé par l’emprunt placé et avec la Facilité pour la résilience sous la bannière de “NextGenerationEU”, pour traverser la crise énergétique induite par la guerre en Ukraine.
En 2025, le plan “ReArm Europe”, doté de “850 milliards €” et destiné à contribuer au réarmement de l’Union, a marqué une nouvelle étape. Rebaptisé “Readiness 2023”, il est composé pour 1/5ème d’un nouvel emprunt commun appelé SAFE (Security Action for Europe) et adopté par les Etats membres le 27 mai. Le reste renvoie à des dépenses nationales mobilisables en dehors des règles budgétaires actuelles via une “escape clause”.
Autour de la table du Conseil européen, les discussions sur le prochain budget n’ont pas encore commencé que déjà le front des “frugaux”, ces pays qui ont longtemps plaidé pour un strict plafonnement des dépenses de l’Union, se fissure. La Première ministre danoise Mette Frederiksen, dont le pays prendra le 1er juillet la présidence tournante de l’UE, a pris ses distances avec ses trois alliés.
“La dernière fois, nous avons eu un rôle dominant parmi les quatre frugaux [ndlr : Autriche, Pays-Bas, Suède, Danemark]. La prochaine fois, nous aurons un rôle dirigeant dans un autre groupe”, a expliqué la semaine dernière celle qui va lancer les négociations entre Etats membres sur le prochain budget.
Draghi et Macron demandent plus d’Eurobonds
En janvier 2024, le président Macron a appelé à reconduire l’expérience au nom du “réinvestissement” dans “les grandes priorités d’avenir”, sans s’étendre sur ces dernières. “Nous devons ouvrir une phase de nouveau réinvestissement comme on l’a fait dans la crise Covid”, a-t-il déclaré depuis Davos.
Le mois dernier, Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne et auteur du rapport sur la compétitivité dont la présidente von der Leyen a fait sa feuille de route, abondait dans ce sens.
“Emettre une dette de l’UE commune pour financer des dépenses communes est une composante clé de la feuille de route politique” de l’UE, a déclaré l’homme du “quoiqu’il en coûte” à Coimbra devant un parterre d’éminences européennes.
Ajoutons que l’émission d’eurobonds à partir de 2021 et l’absorption des fonds par l’Italie et l’Espagne (les deux principaux bénéficiaires de transferts) ont permis, logiquement, de resserrer les spreads entre économies de la zone euro comme jamais depuis 20 ans.
A l’inverse, l’assouplissement des critères d’endettement nationaux dans le cadre de l’Union monétaire est, selon lui, une impasse. Au sujet des 700 milliards de dette nationale rendue possible au titre du réarmement dans le cadre de “ReArm EU”, il a déclaré : “plusieurs pays ont indiqué qu’ils ne feraient pas usage de l’ “escape clause” en raison de leur manque de marge de manoeuvre budgétaire. Cela souligne le fait que
quand la dette est déjà élevée, exempter des catégories de dépenses publiques des règles fiscales ne mène pas très loin”.
Il fait référence aux faibles marges de manoeuvre côté français, italien ou espagnol. En Allemagne, à l’inverse, la levée du frein à la dette nationale pourrait libérer des centaines de milliards d’investissement public dans les années à venir.
Merz pose ses limites et reparle “efficience”
Pour l’instant, le nouveau gouvernement de coalition allemand entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates se garde d’embrasser la perspective de nouvelles émissions d’Eurobonds (obligations émises par l’UE avec garantie conjointe des pays de la zone euro).
“Je partage dans le principe la position du précédent gouvernement” qui s’opposait au principe d’un financement permanent de l’UE par l’emprunt, a déclaré le chancelier Friechrich Merz de passage à Bruxelles le 9 mai (extrait vidéo en fin de post, video complète ici).
“Je ne voudrais pas préempter le résultat des discussions au sein de la coalition [à Berlin] et aussi avec la Commission, mais la règle doit rester que l’UE ne contracte des dettes que dans une situation exceptionnelle”, a-t-il déclaré, omettant au passage les discussions avec… les 26 autes chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union. “C’est l’état du traité de l’UE”.
L’argument allemand, immuable quelle que soit la coalition en place, reste le suivant : l’UE ne levant pratiquement pas d’impôts, elle engage financièrement ses membres quand elle s’endette. Or, en l’état du traité européen, une “Union de transfert” est contraire à la souveraineté bugdétaire du Bundestag, donc à la constitution allemande, donc impossible.
Vu le chemin parcouru depuis le lancement de l’euro et la situation nouvelle créée par le plan de 2020, il faut l’entendre comme une position de négociation, plutôt qu’un “non” définitif. Une position qui a déjà permis à l’Allemagne de peser de tout son poids dans les transformations de l’Union monétaire et, même, de l’Union tout court, depuis deux décennies.
“Ce n’est pas juste une question d’argent, mais aussi d’efficience” de la dépense publique européenne, a d’ailleurs indiqué Friedrich Merz. Le travail des autorités en charge de surveiller l’usage des fonds publics sera dans les mois et les années à venir beaucoup plus qu’un exercice formel ou bureaucratique.
L’art du flou d’Ursula von der Leyen
Dans un bref discours prononcé le 20 mai à Bruxelles, Ursula von der Leyen a dit que “le nouveau budget doit être construit sur une nouvelle structure”.
L’enjeu semble être de modifier les conditions d’accès aux fonds européens et de disposer de plus de “flexibilité”. “Aujourd’hui, 90% du budget est pré-alloué dès le début… avec des flexibilités de moins de 4% du total. C’est beaucoup trop peu… car nous ne savons tout simplement pas ce qui va venir”, a-t-elle expliqué, citant les innovations technologiques, comme l’IA ou les catastrophes naturelles.
La présidente de la Commission souhaite faciliter les transferts entre enveloppes thématiques, quitte à les regrouper. Un grand “Fond européen de compétitivité” regroupant des aides aux entreprises et à la recherche est sur le métier, même si la présidente a assuré depuis que le programme “Horizon”, qui regroupe les subventions à la recherche et à l’innovation, serait préservé.
La Commission envisage de superposer aux enveloppes thématiques (actuellement destinées aux 2/3 à l’agriculture/la pêche et à la cohésion) des enveloppes nationales (ou régionales) comme cela s’est fait pour le plan de relance de 2020.
“Nous nous appuierons sur notre expérience récente en matière de jalons et d'objectifs”, a dit la présidente.
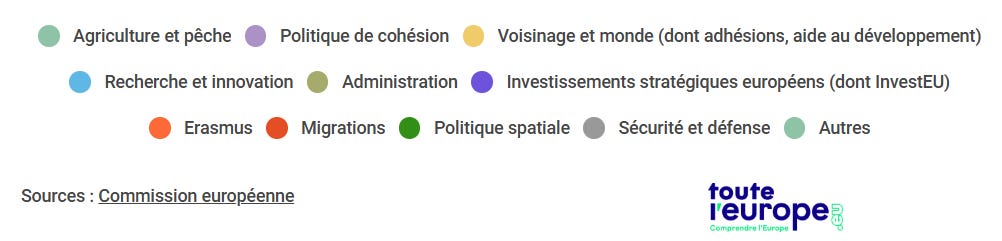
Haro sur les enveloppes nationales
L’idée de “plans nationaux” a pour l’instant été accueillie froidement au Parlement européen, y compris dans le bloc central.
“Nous voulons un vrai budget européen, pas 27 agendas fragmentés. C’est pourquoi nous rejetons la proposition de la Commission d’un plan national par Etat membre… Notre budget doit refléter des priorités communes qui apportent une réelle valeur ajoutée européenne”, a indiqué en mai Siegfried Muresan, député PPE co-rapporteur d’une résolution du Parlement sur le prochain budget.
Même son de cloche chez Renew, le groupe libéral dont font partie les députés français LREM. “Nous rejetons des enveloppes nationales rigides et appelons à une structure qui permette une surveillance effective sans sacrifier la simplification et l’efficience”, a indiqué le groupe dans un communiqué.
Explicitement opposés à une “renationalisation” des fonds européens, les groupes politiques au Parlement se montrent en revanche beaucoup plus évasif quand il s’agit d’emprunts communs.
“Le remboursement de Next Generation EU [qui comprend principalement la FRR, ndlr] doit être clarifié sans quoi les marges de manoeuvre sur l’endettement conjoint seront limitées”, a ainsi averti l’eurodéputé PPE Siegfried Muresan le mois dernier.
Compte à rebours
Cinq ans après le “moment hamiltonien” de 2020, les planètes sont donc alignées pour faire de la question fiscale l’éléphant dans la salle de la machine diplomatique européenne dans les mois et années à venir.
Pour l’instant, les négociations à Vingt-Sept sur de nouvelles “ressources propres”, proposées en 2021 et 2023 par la Commission sont enlisées. Tout indique qu’elles fusionneront avec celles sur le prochain budget pluriannel post-2027 de l’UE.
A défaut d’accord, les deux solutions pour faire face aux premières échéances de remboursement à partir de 2028 consistent à rouler la dette ou à demander aux Etats de lever l’impôt correspondant à leurs engagements (fonds reçus - transferts nets) par le plan de relance Covid.
Annoncé pour le 16 juillet, le projet de budget annuel post-2027 a été scindé en deux. L’ordre du jour provisoire de la réunion du collège du 23 juillet prévoit ainsi que la présidente von der Leyen y présente un “second groupe de propositions sectorielles”.
Il restera ensuite, au maximum, un peu moins de deux ans et demi aux Vingt-Sept pour s’entendre./.
Extrait de la conférence de presse du chancelier Merz, à Bruxelles, le 9 mai 2025 (EBS)






